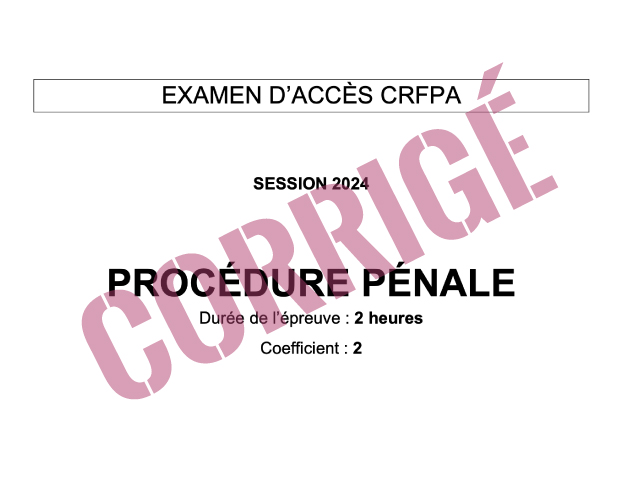Le sujet est disponible ici ! objectif-barreau.fr
- Et si vous prépariez le CRFPA avec un tuteur rédacteur expérimenté ?
- Consultez toutes les fiches CRFPA de Doc-du-juriste !
David a été arrêté pour avoir dérobé un téléphone portable. Au regard de la procédure suivie, trois points doivent être examinés : d’abord, la régularité des premiers actes d’enquête réalisés (I), ensuite, celle de la perquisition effectuée au domicile de David et de son second placement en garde à vue (II), enfin, celle de savoir si David et son comparse peuvent être jugés pour des faits antérieurs (III).
I - La régularité des premiers actes d’enquête
Les enquêteurs ont requis en premier lieu l’accès à des images de vidéosurveillance (B), avant de procéder à la géolocalisation du téléphone portable volé (C). Il convient préalablement de préciser le cadre juridique dans lequel ces actes s’inscrivent (A).
A - Le cadre de l’enquête
Aux termes de l’article 53 du Code de procédure pénale (CPP), le crime ou délit flagrant est celui « qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ». Ce texte impose la réunion de plusieurs conditions.
La première condition concerne la nature même de l’infraction, qui doit constituer un crime ou un délit. En l’espèce, les faits dénoncés consistent en un vol, qui reçoit une qualification délictuelle. Cette première condition est donc remplie.
La deuxième condition est temporelle. Elle suppose que les faits soient en train de se commettre ou qu'ils aient été commis dans un temps très proche.
En l'espèce, la victime a porté plainte quelques minutes après le vol, de sorte que la condition temporelle est bien remplie.
La troisième condition porte sur l'apparence : il doit exister des « indices apparents d'un comportement délictueux » (Crim., 22 janvier 1953, Isnard). Selon la jurisprudence, une dénonciation anonyme non corroborée est insuffisante (Crim., 11 juillet 2007), mais une dénonciation non anonyme faite aux policiers constitue un indice objectif suffisant (Crim., 1er octobre 2003).
En l'espèce, c'est la victime elle-même qui s'est présentée au commissariat pour dénoncer les faits. Cette condition est donc également satisfaite.
En conséquence, les investigations relèvent du cadre de l'enquête de flagrance. Il convient maintenant d'examiner la régularité des actes diligentés.
B - L’accès aux images de vidéosurveillance
Selon l’article 60-1 du CPP, les officiers de police judiciaire (OPJ) peuvent requérir de toute personne, établissement ou organisme susceptible de détenir des informations utiles à l'enquête, notamment numériques, de leur remettre ces éléments. Les images issues d'un dispositif de vidéosurveillance entrent dans cette catégorie.
En l'espèce, les OPJ ont requis auprès du propriétaire d'une boutique les images de vidéosurveillance, leur permettant ainsi d'identifier les deux comparses qui n'avaient pas dissimulé leurs visages. Ces réquisitions apparaissent parfaitement régulières.
C - La géolocalisation du téléphone portable
En matière de géolocalisation, le Code de procédure pénale prévoit plusieurs régimes distincts, selon que l’objet géolocalisé appartient à l’auteur présumé de l’infraction ou à sa victime.
D’un côté, l’article 230-32 CPP permet la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans l’accord de son propriétaire ou détenteur. De l’autre, l’article 230-44 CPP exclut l’application de ce régime lorsque la géolocalisation concerne un appareil appartenant à la victime de l’infraction. Dans ce cas, le second alinéa de cet article prévoit que l’opération s’effectue par voie de réquisitions, conformément aux articles 60-1 et 60-2 CPP. Toutefois, ce régime spécifique ne s’applique que si la localisation vise à retrouver la victime, l’objet volé ou une personne disparue (art. 230-44, al. 1 CPP).
En l’espèce, la géolocalisation semble avoir eu pour but de localiser le téléphone volé, mais aussi — et surtout — de retrouver les deux suspects. Les policiers estimaient en effet que là où se trouverait l’appareil, se trouveraient aussi les deux individus. Ce double objectif crée une incertitude quant au cadre juridique applicable.
Si l’objectif principal était de localiser le téléphone lui-même, il convient d’appliquer le régime des réquisitions informatiques. Or, l’article 60-1 CPP, auquel renvoie l’article 230-44 al. 2, réserve l’application de l’article 60-1-2. Ce dernier précise que de telles réquisitions sont possibles si elles visent les équipements terminaux de la victime, à sa demande, et dans le cadre d’un délit passible d’emprisonnement (art. 60-1-2, 3°).
En l’espèce, aucune indication ne permet d’affirmer que la victime a sollicité cette mesure, ce qui constitue une potentielle irrégularité.
Si, au contraire, l’intention réelle des enquêteurs était de localiser les auteurs présumés, c’est le régime général des articles 230-32 et suivants qui s’applique. Ce cadre juridique impose plusieurs conditions strictes.
Premièrement, la mesure doit se justifier par les nécessités d’une enquête relative à un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement (art. 230-32, 1° CPP). Ici, le vol, puni de trois ans, entre dans ce champ.
Deuxièmement, l’autorisation du procureur est requise pour une enquête de flagrance (art. 230-33, 1° CPP). Une dérogation est toutefois prévue en cas d’urgence, lorsque la mesure vise à prévenir un risque imminent de disparition de preuves ou une atteinte grave aux personnes ou aux biens (art. 230-35 CPP). Dans cette hypothèse, l’OPJ peut prendre l’initiative de la mesure, mais doit en informer immédiatement le procureur.
En matière de géolocalisation via téléphone portable, l’intervention du juge des libertés et de la détention (JLD) peut également s’avérer nécessaire à deux titres.
D’une part, lorsque la localisation en temps réel suppose une activation à distance de l’appareil électronique, l’article 230-34-1 impose l’autorisation du JLD ou du juge d’instruction, sous réserve que la peine encourue soit d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
D’autre part, la Cour de cassation a récemment jugé que les articles 230-32 et 230-33, qui confèrent au procureur le pouvoir d’autoriser la géolocalisation d’une ligne téléphonique en temps réel, sont contraires au droit de l’Union. Elle exige désormais l’intervention d’un magistrat du siège et réserve cette mesure aux affaires de criminalité grave (Crim., 27 févr. 2024, n° 23-81.061). La CJUE, dans un arrêt du 4 novembre 2024 (C-548/21, §102), a également affirmé que tout accès par les autorités à des données personnelles, en cas de risque d’ingérence grave dans les droits fondamentaux, doit faire l’objet d’un contrôle préalable par une autorité judiciaire ou indépendante.
Cependant, toutes ces décisions visent la géolocalisation de lignes téléphoniques appartenant aux personnes poursuivies. Certes, ni la Cour de cassation ni la CJUE ne distinguent explicitement selon que la ligne appartient à l’auteur ou à la victime. Mais leur objectif étant de protéger la vie privée et la confidentialité des données personnelles, on peut raisonnablement penser que ces exigences ne s’appliquent pas avec la même rigueur lorsque la ligne appartient à la victime.
En l’espèce, la géolocalisation du téléphone de la victime a été décidée par les OPJ sans autorisation du procureur ni du JLD, invoquant une situation d’urgence. Or, le simple risque d’atteinte à un bien ne semble pas suffisant pour justifier cette dérogation, au regard de l’article 230-35 CPP. En tout état de cause, même en cas d’urgence légitime, l’information immédiate du procureur était requise — or, rien n’indique qu’elle ait été faite.
En définitive, quelle que soit l’interprétation du cadre applicable, la mesure de géolocalisation apparaît entachée d’irrégularité. Sa nullité pourrait dès lors être soulevée.
Il convient toutefois de rappeler que toute demande en nullité est soumise à deux conditions de recevabilité, dégagées par la jurisprudence (Crim., 7 sept. 2021, n°20-87191).
Premièrement, le requérant doit justifier d’un intérêt à agir, c’est-à-dire que l’acte contesté doit le concerner directement. Deuxièmement, il doit disposer de la qualité à agir, ce qui suppose que la norme méconnue ait pour finalité la protection d’un droit qui lui est propre.
En matière de géolocalisation, la Cour de cassation a précisé que le moyen tiré d’une irrégularité dans la mise en œuvre de la géolocalisation, ou dans l’exploitation des données ainsi obtenues, peut être invoqué par la personne titulaire d’un droit sur l’objet géolocalisé ou par celle qui démontre une atteinte à sa vie privée (Crim., 28 mai 2024, n°23-86.390).
En l’espèce, la géolocalisation a permis de localiser le téléphone au domicile de David. Toutefois, ce téléphone ne lui appartenait pas, et il n’a été localisé qu’indirectement. Dès lors, la reconnaissance de sa qualité à agir demeure incertaine.
Par ailleurs, hormis les cas où la nullité est d’ordre public ou où le grief est présumé, le requérant doit établir l’existence d’un grief résultant de l’irrégularité. Or, en l’espèce, la démonstration d’un tel grief paraît difficile à établir.
II – La régularité de la perquisition et de la garde à vue
Le domicile de David a fait l’objet d’une perquisition, suivie d’un placement en garde à vue. Il convient d’en apprécier séparément la régularité.
A - La perquisition
En préambule, il importe de souligner que l’éventuelle nullité de la géolocalisation n’affecte pas la validité de la perquisition. D’une part, David ne semble pas en mesure de faire valoir utilement cette nullité. D’autre part, il est précisé que les policiers avaient prévu de se rendre à son domicile indépendamment des données de localisation. La perquisition ne repose donc pas exclusivement sur ces dernières.
Les règles relatives aux perquisitions sont fixées aux articles 56 et suivants du Code de procédure pénale. En matière de flagrance, elles doivent être réalisées en présence de la personne chez laquelle elles sont effectuées (art. 57 CPP), sans que son accord soit nécessaire.
Par ailleurs, en application de l’article 59 CPP, ces opérations doivent se dérouler entre 6 heures et 21 heures.
En l’espèce, la perquisition a eu lieu à 17h, dans le respect des horaires légaux. David était présent au moment des faits, et son opposition n’est pas de nature à vicier la mesure, celle-ci s’inscrivant dans une enquête de flagrance. La perquisition apparaît donc régulière.
B - La garde à vue
David a été placé en garde à vue à 17h. Deux éléments doivent être analysés : les conditions du placement (1) et les modalités de l’audition (2).
1. Le placement en garde à vue
L’article 62-2 CPP prévoit que toute personne soupçonnée de la commission d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement peut être placée en garde à vue, sous réserve de l’existence d’indices plausibles.
Par ailleurs, l’article 63 impose à l’OPJ d’informer immédiatement le procureur de la République du placement en garde à vue. L’article 63-1 prévoit également que la personne doit être informée sans délai de la mesure, de la qualification des faits reprochés et de ses droits.
En l’espèce, les OPJ interpellent David à 17h à son domicile et lui notifient alors son placement en garde à vue, les faits visés ainsi que ses droits. Une seconde notification est faite au commissariat. Si la première notification est complète, elle suffit à satisfaire les exigences légales.
En revanche, l’information du procureur ne sera faite qu’à 18h, soit une heure après le placement. Or, la jurisprudence exige que cette information intervienne immédiatement, sauf circonstance insurmontable. Un délai compris entre 30 et 45 minutes est déjà jugé excessif et peut entraîner la nullité de la mesure (Crim., 24 mai 2016, n°16-80.564 P).
Aucune justification particulière n’est donnée en l’espèce pour expliquer ce retard. Par conséquent, cette information tardive constitue une irrégularité.
Sur ce fondement, David pourrait soulever une nullité, dès lors qu’il justifie d’un intérêt à agir (l’acte le concerne personnellement) et d’une qualité à agir, la disposition ayant pour objet de protéger ses droits. À l’inverse, son comparse Cyril, qui n’a pas été concerné par cette mesure, ne pourrait pas invoquer une telle irrégularité.
Enfin, s’agissant du grief, la Cour de cassation considère que tout retard injustifié dans la notification des droits ou l’information du procureur cause nécessairement un préjudice à la personne concernée (Crim., 10 mai 2001, n°01-81.441).
Ainsi, David n’a pas à démontrer ce grief : il est présumé du seul fait du retard.
2. L’audition de David
Il convient, en premier lieu, de souligner que l’audition de David s’inscrit dans le cadre d’une garde à vue dont la régularité est contestée. Or, l’audition repose nécessairement sur cette mesure privative de liberté. Par conséquent, si la garde à vue devait être annulée, l’audition serait frappée de nullité par voie de conséquence.
Cela étant précisé, il ne semble pas qu’une autre irrégularité propre à cette audition puisse être retenue.
Dès le début de la garde à vue, la personne concernée bénéficie du droit à l’assistance d’un avocat. Si elle sollicite cette assistance, aucune audition ne peut avoir lieu sans la présence de l’avocat choisi ou désigné d’office.
Le régime applicable a été modifié par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (art. 34), entrée en vigueur au 1er juillet 2024. Avant cette date, en cas de demande d’assistance, l’audition ne pouvait débuter qu’après l’expiration d’un délai de carence de deux heures (ancien art. 63-4-2 CPP). Ce délai permettait à l’avocat d’arriver sur place.
La réforme a supprimé ce délai. Désormais, si l’avocat n’est pas présent au bout de deux heures, le bâtonnier est saisi pour désigner un avocat commis d’office (art. 63-3-1 CPP). Sauf renonciation expresse du gardé à vue, mentionnée au procès-verbal, l’audition ne peut commencer sans l’avocat (art. 63-4-2 CPP).
En l’espèce, la garde à vue a été initiée le 24 juin 2024, donc avant l’entrée en vigueur de la réforme. Les anciennes dispositions s’appliquent. Or, trois heures se sont écoulées entre l’arrivée au commissariat et le début de l’audition. Le délai de deux heures a donc été respecté, et aucune irrégularité ne peut être soulevée à ce titre.
Dès lors, les déclarations incriminantes de David recueillies lors de cette audition ne pourront être contestées sur le fondement d’un vice propre à cette phase de procédure.
III – Les faits anciens
David et Cyril ont été cités à comparaître pour des faits commis le 24 juin 2024, selon les termes suivants : « en tout cas par un temps non couvert par la prescription ». Ils s’interrogent sur la portée de cette formule, ayant par ailleurs commis d’autres vols.
Sur ce point, l’article 388 du Code de procédure pénale dispose que le tribunal correctionnel est saisi des infractions relevant de sa compétence : « soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ».
Ainsi, la saisine du tribunal est strictement déterminée par les termes de l’acte de saisine, notamment la citation à comparaître. La jurisprudence confirme régulièrement que les juridictions répressives ne peuvent statuer que sur les faits visés dans la citation ou l’ordonnance de renvoi (Crim., 29 janv. 1970, n°67-92.054 ; Crim., 5 juin 1996, n°95-83.265 ; Crim., 19 avr. 2005, n°04-83.879). Le juge ne peut donc élargir sa compétence temporelle à des faits non visés, sauf acceptation expresse du prévenu (Crim., 12 oct. 2022, n°21-82.440).
Ce principe a été récemment rappelé dans un arrêt du 30 avril 2024. La Cour de cassation y précise que l’ajout de la mention « en tout cas depuis un temps non couvert par la prescription » ne modifie en rien l’étendue de la saisine dans le temps. Cette formule vise uniquement à établir que les faits poursuivis ne sont pas prescrits.
En l’espèce, la citation mentionne clairement des « faits de vol en réunion commis le 24 juin 2024 », assortis de la mention « en tout cas par un temps non couvert par la prescription ». Dès lors, le tribunal correctionnel est uniquement saisi des faits commis à cette date. Il ne pourra donc connaître d’éventuels vols plus anciens que si David et Cyril y consentent expressément.
Ainsi, sauf acceptation formelle de leur part, les deux prévenus ne peuvent être jugés que pour les faits mentionnés dans la citation à comparaître. Ils n’ont donc pas à craindre de poursuite immédiate pour des faits antérieurs à ceux visés.
Exemples de corrigé des épreuves 2024 du CRFPA
- Corrigé CRFPA 2024 - Droit administratif
- Corrigé CRFPA 2024 - Droit des obligations
- Corrigé CRFPA 2024 - Note de synthèse
- Corrigé CRFPA 2024 - Procédure administrative et contentieuse
- Corrigé CRFPA 2024 - Droit des affaires
- Corrigé CRFPA 2024 - Droit social
- Corrigé CRFPA 2024 - Droit pénal
- Corrigé CRFPA 2024 - Droit international et européen
- Corrigé CRFPA 2024 - Droit fiscal