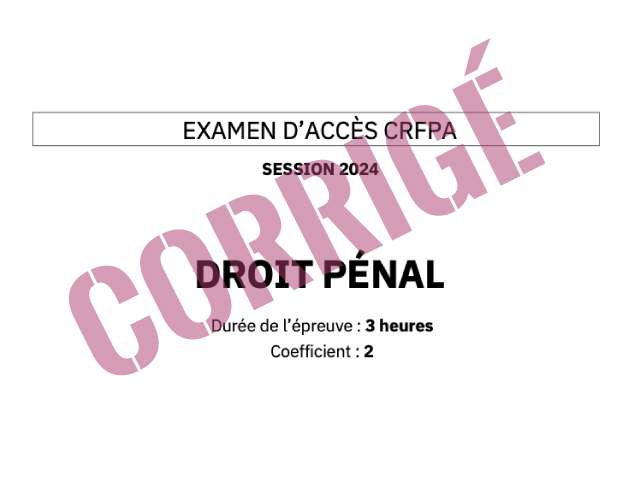I. La responsabilité pénale d’Hélène
En projetant de la peinture noire sur les photographies de Bertrand, Hélène s’expose à des poursuites pour dégradation ou destruction du bien d’autrui (A).
Étant donné le contexte militant entourant son geste, il sera nécessaire d’examiner l’éventuelle application d’un fait justificatif lié à la liberté d’expression (B). Enfin, dans l’hypothèse où la destruction des photographies aurait contribué au suicide de Bertrand, il conviendra d’envisager la question d'un éventuel homicide involontaire (C).
A. Les dégradations volontaires
La qualification pénale de dégradations volontaires suppose la réunion de deux éléments cumulatifs : un élément matériel (1) et un élément moral (2).
1) L’élément matériel
L’analyse du résultat du comportement permet tout d’abord d’identifier la bonne qualification (a), avant d’examiner l’acte lui-même (b).
a) Le résultat
Les infractions de dégradation ou destruction nécessitent une atteinte effective à l’intégrité d’un bien.
Selon l’ampleur du dommage, l’infraction relèvera soit du délit de l’article 322-1, I du Code pénal, soit d’une simple contravention si les dommages sont jugés légers (article R. 635-1 du Code pénal).
L’article 322-1, II prévoit en particulier une contravention pour des dégradations légères telles que des inscriptions ou dessins sur les façades, véhicules, voies publiques ou mobilier urbain. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable en l’espèce : les photographies visées constituent des œuvres d’art et ne peuvent être assimilées aux biens mentionnés.
En outre, la notion de « dommage léger » est écartée dès lors que l’atteinte porte sur la substance même du bien, comme l’a rappelé la chambre criminelle dans un arrêt du 1er juin 1994 (n° 93-84.966).
En l’espèce, la peinture noire indélébile projetée par Hélène sur les photographies de Bertrand altère irrémédiablement leur substance.
Le dommage étant conséquent, la qualification délictuelle de l’article 322-1, I CP doit donc être retenue.
Par ailleurs, les photographies sont des biens mobiliers appartenant à Bertrand, remplissant ainsi pleinement les conditions de l’infraction.
b) L’acte
Tout acte positif ayant provoqué la dégradation ou la destruction du bien est susceptible de caractériser l’élément matériel.
En l’occurrence, le geste d’Hélène consistant à asperger de peinture noire les œuvres constitue indiscutablement un acte matériel de dégradation.
2) L’élément moral
Les dégradations volontaires constituent une infraction intentionnelle.
En application de l’article 121-3, alinéa 1er du Code pénal, l’élément moral suppose la conscience et la volonté de porter atteinte au bien, ce que l’on désigne comme le dol général.
Ici, cette intention est manifeste : Hélène revendique ouvertement son acte, qu’elle justifie par son engagement en faveur de la cause environnementale.
Le mobile, aussi louable soit-il, est indifférent à la caractérisation de l’intention délictueuse. Il pourrait néanmoins être invoqué pour discuter d’une éventuelle cause d’irresponsabilité.
B. Le fait justificatif tiré de la liberté d’expression
Hélène assume son geste comme une action militante visant à sensibiliser l’opinion publique sur le changement climatique, dans le cadre d’une exposition sponsorisée par un groupe pétrolier et en présence d’une ministre.
Elle pourrait ainsi revendiquer la protection conférée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, relatif à la liberté d’expression.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, sous l'influence de la jurisprudence européenne, a admis que la liberté d’expression pouvait, dans certains cas, justifier des infractions pénales.
Initialement limitée aux infractions de presse, cette approche a été progressivement étendue à d’autres infractions de droit commun (Crim. 26 oct. 2016, escroquerie ; Crim. 26 févr. 2020, n° 19-81.827, exhibition sexuelle d’une militante Femen ; Crim. 18 mai 2022, n° 20-87.272, 21-86.647 et 21-86.685, concernant les « décrocheurs » du portrait présidentiel).
Néanmoins, pour que la liberté d’expression puisse justifier une infraction, plusieurs conditions doivent être réunies :
- L’infraction doit s’inscrire dans le cadre d’un débat d’intérêt général ;
- L’atteinte doit être proportionnée, appréciée au regard des circonstances de l’espèce et de la gravité du dommage causé ;
S’agissant des atteintes aux biens, il convient également de prendre en compte la valeur du bien atteint et le caractère irréversible du préjudice.
En l’espèce, le contexte militant de l’action d’Hélène, ses déclarations publiques, ainsi que le cadre dans lequel elle a agi (exposition financée par une entreprise pétrolière en présence d'une personnalité politique), permettent de rattacher son acte à un débat d’intérêt général sur la protection de l’environnement.
Cependant, la question de la proportionnalité se pose sérieusement : la destruction définitive d’œuvres d’art constitue un préjudice grave et irréversible.
En comparaison avec la jurisprudence relative aux « décrocheurs » du portrait présidentiel (Crim. 18 mai 2022), où l’atteinte aux biens était jugée minime et réversible, la destruction totale des photographies par Hélène paraît manifestement disproportionnée.
Par conséquent, malgré le contexte d’intérêt général, le fait justificatif tiré de la liberté d’expression ne semble pas pouvoir être retenu en l’espèce.
C. L’homicide non intentionnel
Bertrand ayant mis fin à ses jours après la destruction de ses photographies par Hélène, se pose la question de la responsabilité pénale de cette dernière pour homicide involontaire, au sens de l’article 221-6 du Code pénal.
Si le décès de Bertrand ne soulève aucune difficulté quant au résultat de l’infraction, deux éléments restent à analyser de manière approfondie : le lien de causalité (1) et la faute (2).
1) Le lien de causalité
En matière d'infractions non intentionnelles, deux points méritent une attention particulière : d’une part, la certitude du lien causal (a) ; d’autre part, son caractère direct ou indirect, tel que visé par l'article 121-3, alinéa 4 du Code pénal (b).
a) La certitude du lien de causalité
La jurisprudence impose que le lien de causalité soit certain. Toutefois, la méthode d’appréciation de cette certitude n’est pas totalement stabilisée, oscillant entre deux grandes théories :
- La théorie de l’équivalence des conditions, selon laquelle toute faute ayant concouru à la survenance du dommage est considérée comme cause certaine.
En vertu de cette approche, tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit est constitutif d’un lien causal.
- La théorie de la causalité adéquate, qui retient uniquement les fautes ayant joué un rôle déterminant dans la production du résultat.
La jurisprudence, sans se fixer clairement, a déjà admis, notamment en matière de suicide consécutif à un accident de la circulation, que le lien causal pouvait être retenu (Crim., 14 janvier 1971, n° 69-92.994 ; Crim., 29 mai 2001, n° 00-85.421).
En l’espèce, selon la théorie de l’équivalence des conditions, on peut soutenir que, sans l’acte de vandalisme d’Hélène, Bertrand ne se serait pas suicidé.
L’acte d’Hélène constitue donc un antécédent nécessaire au décès, permettant de retenir une causalité certaine.
En revanche, si l’on se place du point de vue de la causalité adéquate, l’analyse est plus nuancée : selon le cours normal des choses, la destruction de photographies, même définitive, n’est pas en soi de nature à entraîner un suicide. Le caractère inhabituel de la réaction de Bertrand invite à relativiser l'imputabilité directe du décès.
La question de la certitude du lien causal reste donc délicate, mais à supposer qu’elle soit admise, encore faudrait-il déterminer si le lien est direct ou indirect.
b) Le caractère direct ou indirect du lien de causalité
L'article 121-3, alinéa 4 du Code pénal distingue l’auteur direct du dommage de celui qui a seulement contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage.
La jurisprudence retient deux critères principaux pour opérer cette distinction :
La proximité temporelle entre la faute et le dommage ;
Le caractère déterminant de la faute dans la survenance du dommage (Crim., 25 septembre 2001, n° 01-80.100 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-84.575).
Dans le cas présent, le geste de vandalisme d’Hélène précède de plusieurs semaines le suicide de Bertrand, sans lien spatio-temporel immédiat.
Par ailleurs, la destruction des photographies ne peut être regardée comme déterminante de manière évidente.
Ainsi, Hélène doit être considérée comme l'auteur indirect du dommage, ce qui aura des conséquences sur la nature de la faute exigée pour engager sa responsabilité.
2) La faute
Lorsque le lien de causalité est indirect, l'article 121-3, alinéa 4 du Code pénal impose la preuve d'une faute qualifiée : soit une faute délibérée, soit une faute caractérisée.
La faute délibérée suppose la violation manifestement intentionnelle d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par un texte.
La faute caractérisée, quant à elle, suppose l’exposition d’autrui à un risque grave que l’auteur ne pouvait ignorer.
En l'espèce, aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité n’est applicable à la situation, de sorte que seule la faute caractérisée pourrait être envisagée.
Or, il paraît difficile de soutenir que la destruction d'un bien, même lourd de conséquences affectives pour son propriétaire, exposait celui-ci à un risque grave pour son intégrité physique ou sa vie.
Il est tout aussi délicat d’affirmer qu’Hélène avait conscience, en agissant ainsi, de faire courir un risque corporel à Bertrand.
Par conséquent, en l'absence de faute caractérisée, la responsabilité pénale d’Hélène ne pourra être engagée pour homicide involontaire.
Conclusion :
Même si un lien de causalité pouvait être établi entre l’acte d’Hélène et le suicide de Bertrand, l'absence de faute qualifiée exclut toute responsabilité pénale de sa part en tant qu'auteur indirect du dommage.
II. La responsabilité pénale du policier
A. L’hypothèse de la tentative de meurtre
Si l’intention de tuer peut être établie, l'absence de décès de la victime ne fait pas obstacle à la répression : il conviendra alors de retenir la tentative de meurtre, infraction punie de trente ans de réclusion criminelle en raison de sa gravité.
Pour qualifier juridiquement une tentative de meurtre, il faut classiquement vérifier que les conditions posées par l’article 121-5 du Code pénal sont réunies, à savoir : la réunion d’un élément matériel (1) — un commencement d’exécution sans désistement volontaire — et d’un élément moral (2).
1) L’élément matériel
L’analyse de l’élément matériel de la tentative suppose de s'assurer de deux conditions cumulatives : l'existence d'un commencement d'exécution (a) et l'absence de désistement volontaire (b).
a) Le commencement d'exécution
Le commencement d’exécution, au sens de l’article 121-5 du Code pénal, est défini par la jurisprudence comme tout acte tendant directement et immédiatement à la consommation de l’infraction, impliquant une certaine proximité tant causale que temporelle avec la réalisation du résultat (v. Crim., 25 oct. 1962, Lacour, Schieb et Benamar).
En l'espèce, si l'intention homicide est démontrée, le tir dirigé vers le haut du corps de la victime constitue un acte directement orienté vers l'atteinte létale, ainsi que l'a confirmé l'expertise médicale, et répond donc aux exigences du commencement d’exécution.
b) L’absence de désistement volontaire
L’article 121-5 prévoit que la tentative n'est punissable que si l’auteur n’a pas volontairement renoncé à son action avant que le résultat ne se produise. Le désistement doit ainsi intervenir spontanément, sans contrainte extérieure, et avant que l’acte ne cause un dommage.
En l’espèce, le policier ayant effectivement blessé Hélène par son tir, toute intervention ultérieure, même bénéfique, ne peut être assimilée à un désistement volontaire mais relève du repentir actif, qui n’efface pas la tentative.
Dès lors, l’élément matériel de la tentative semble constitué. Il reste cependant à établir l’élément moral.
2) L’élément moral
Le meurtre, y compris tenté, demeure une infraction intentionnelle exigeant la preuve de l'intention de tuer, conformément à l’article 121-3, alinéa 1er du Code pénal.
En l’espèce, le policier a tiré volontairement sur Hélène.
Certes, il affirme avoir voulu l'immobiliser, mais ses propos, évoquant une volonté d'agir « par tous les moyens », ainsi que son aversion notoire pour les militants écologistes, invitent à s'interroger sur la sincérité de cette déclaration.
Son statut de tireur expérimenté rend peu crédible l’hypothèse d’une erreur de visée lorsqu’on sait que le haut du corps est visé, partie particulièrement vulnérable.
La jurisprudence retient par ailleurs une présomption d'intention homicide dès lors qu'une arme létale est employée pour viser une zone vitale (v. Crim., 6 nov. 1956 ; Crim., 15 mars 2017, n° 16-87.694).
De plus, un repentir actif, tel que l’assistance médicale portée après coup, ne suffit pas à neutraliser l’intention initiale (v. Crim., 21 juin 2017 ; 27 mars 2019).
Il est donc tout à fait envisageable, au regard de la jurisprudence, de qualifier les faits de tentative de meurtre.
À défaut d'intention de tuer démontrée, il conviendra toutefois de s’orienter vers une qualification de violences (B).
B. L’hypothèse des violences en l'absence d’intention homicide
Lorsque l’intention de donner la mort n'est pas avérée, les faits doivent être requalifiés en violences volontaires, la gravité de la qualification dépendant alors du préjudice subi par la victime.
L’analyse repose sur trois éléments : l’étendue du dommage pour retenir la bonne qualification (1), la caractérisation de l’acte de violence (2), et enfin l’établissement de l’intention (3).
1) Le résultat et la qualification
La qualification pénale des violences dépend de la gravité de l’atteinte : violence ayant entraîné la mort (art. 222-7 CP), mutilation ou infirmité permanente (art. 222-9 CP), ITT supérieure à huit jours (art. 222-11 CP), ITT inférieure ou égale à huit jours (art. R. 625-1 CP), ou violences sans ITT (art. R. 624-1 CP).
En l'espèce, Hélène a été blessée par une arme à feu au niveau d'une zone vitale.
Bien que l’énoncé ne précise pas la durée exacte de l’incapacité, la gravité de la blessure laisse raisonnablement supposer une ITT supérieure à huit jours, justifiant l’application de l'article 222-11 du Code pénal.
2) L’acte de violence
La notion d'acte de violence n’est pas précisément définie par les textes, mais est appréciée de manière souple par la jurisprudence : tout acte positif ayant entraîné une atteinte corporelle peut être qualifié de violence.
Ici, le tir du policier constitue un acte incontestable de violence.
3) L’intention
L'infraction de violences volontaires suppose que l’auteur ait eu la volonté de porter atteinte à l’intégrité physique d'autrui, sans nécessité d’avoir recherché le dommage spécifique subi.
Le policier a sciemment tiré sur la victime dans l'intention manifeste de l’atteindre pour l’immobiliser, ce qui suffit à caractériser l’élément intentionnel.
Par ailleurs, deux circonstances aggravantes peuvent être retenues : l'usage d’une arme (art. 222-12, 7° CP) et le fait que l’auteur soit dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions (art. 222-12, 10° CP).
Ces circonstances entraînent une peine portée à sept ans d’emprisonnement et une amende d'un million d’euros.
C. Le fait justificatif : l’autorisation d’usage de l’arme
Le policier pourrait-il invoquer un fait justificatif fondé sur l’autorisation d’usage de l'arme ?
On pourrait théoriquement combiner les articles 122-4 du Code pénal (autorisation de la loi) et L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure, qui encadrent l'usage des armes par les forces de l'ordre.
Toutefois, ce fait justificatif ne saurait prospérer ici pour deux raisons :
D’une part, en cas de fuite d’une personne non armée à pied (art. L. 435-1, 3° CSI), l'usage de l'arme n'est autorisé qu'après sommations et uniquement si la personne représente un danger pour autrui.
Or, aucune sommation n’a été faite, et Hélène, non armée, ne constituait pas une menace immédiate.
D’autre part, l'usage de la force doit être strictement nécessaire et proportionné.
Tirer dans le haut du corps d'une personne en fuite sans danger imminent pour autrui apparaît manifestement disproportionné.
Ainsi, le policier ne pourra utilement se prévaloir du fait justificatif d'autorisation légale.
Exemples de corrigé des épreuves 2024 du CRFPA
- Corrigé CRFPA 2024 - Droit administratif
- Corrigé CRFPA 2024 - Droit des obligations
- Corrigé CRFPA 2024 - Note de synthèse
- Corrigé CRFPA 2024 - Procédure administrative et contentieuse
- Corrigé CRFPA 2024 - Droit des affaires
- Corrigé CRFPA 2024 - Droit social
- Corrigé CRFPA 2024 - Procédure pénale
- Corrigé CRFPA 2024 - Droit international et européen
- Corrigé CRFPA 2024 - Droit fiscal
- Tous les sujets du CRFPA 2024 sont disponibles ici : https://www.objectif-barreau.fr/sujets-crfpa-2024